Trois polars, trois styles
Selon une étude menée sur le marché de l’édition en France en 2003, sur près de 100 millions de romans vendus, le policier représentait 15,6 millions, dont près de 13 millions en format poche. En 2003, le chiffre d'affaires global du roman était de 423,5 millions d'euros dont 62 millions d'euros pour le policier, 38,1 millions pour les Poches. Le genre fait recette.
Au Canada, la récente étude sur la lecture et achat de livres pour la détente du ministère du Patrimoine canadien révèle que la catégorie dite «Espionnage, suspense, détective, aventure» se classait au premier rang des préférences de 24 % des femmes et de 14 % des hommes.
Pour ma part, j’ai habituellement peu le temps de lire des polars, et il me faut attendre la pause estivale pour m’y adonner. J’en ai lu trois récemment, trois très différents.
Dans le polar, et ceci s’applique à tous les autres genres d’écriture, tout tient au style. Et qu’est-ce que le style? Le thème même a inspiré certains grands. «Le style n’est que l’ordre et le mouvement qu’on met dans ses pensées» (Buffon). «Le style n’est qu’une manière de penser» (Flaubert). «Le style, c’est l’oubli de tous les styles» ou encore «Le style, c’est le mot qu’il faut» (Jules Renard).
Trois polars lus récemment, donc, et trois styles.
Journal d’un tueur sentimental de Luis Sepúlveda, traduit de l’espagnol par Jeanne Peyras, Editions Métaillé, 1998. Dans ce livre, l’auteur chilien fait dans le bref, 75 pages en gros caractères, une heure de lecture tout au plus. Comme journal aussi, c’est succinct, l’action se déroule sur une période de six jours. Écrit à la première personne, on ne connaît jamais le prénom ou le nom de ce tueur à gages, ni ceux de la Française dont il s’est amouraché, ni celui de son employeur, seule sa cible fait exception. Si bref et si concis est ce récit qu’on a peine à en décrire la trame sans dévoiler l’issue, sauf pour dire qu’on se retrouve en enfilade d’hôtels, d’avions, et de coups de téléphone pour une conclusion pour le moins abrupte. Le style est froid, contrairement à certains autres ouvrages de Sepúlveda, et le déroulement simpliste. Dommage.
La peau du tambour de Arturo Pérez-Reverte, traduit de l’espagnol par Jean-Pierre Quijano, Éditions du Seuil, 1997. Lorenzo Quart, le père Lorenzo Quart, est agent au service de l’Instituto Per Le Opere Esteriore (IOE) du Vatican, officiellement l’Institut pour les oeuvres extérieures, mais mieux connu comme le bras armé du Saint-Office, le service de renseignement du Vatican, «la main gauche de Dieu», «le service des sales affaires».
Un hacker s’introduit dans le système informatique central du Vatican et dépose un message dans la boîte de courriel personnelle du Saint-Père. Surnommé Vêpres par les services informatiques du Saint-Siège qui sont incapables de repérer l’origine de la communication, le pirate dit vouloir attirer l’attention du pape sur une petite église de Séville, construite au XVIIe siècle, et qui est l’objet de la convoitise de spéculateurs fonciers. «Une église qui tue pour se défendre...» écrit Vêpres. C’est l’église Nuestra Señora de las Lágrimas, Notre-Dame des Larmes, où deux morts suspectes se sont produites en peu de temps. L’IOE est saisie de l’affaire, et Quart hérite de la mission de l’éclaircir.
Ce n’est pas un roman de techno-fiction comme pourrait le laisser croire l’entrée en matière. Ce qui est au centre du roman c’est plutôt l’enquête à dimension très humaine que mènera Quart à Séville, les rencontres qu’il y fera, les tentations auxquelles il sera confronté. Comme disait La Bruyère, «Tout est tentation à qui la craint», et c’est le cas de Quart quant il fait la rencontre d’une aristocrate andalouse.
Le style de Pérez-Reverte, du moins en traduction, est efficace et alerte. En plus de généreuses précisions historiques sur la ville de Séville et de belles descriptions de la ville, l’auteur ouvre la porte sur les arcanes du Vatican. Après tout, que faisait Quart en mission pour l’IOE au Panama au moment de l’invasion étasunienne et de la chute de Noriega, et à Sarajevo aux plus sombres moments de la guerre civile? Des feux de souvenirs qui viendront hanter Quart par les chaudes nuits sévillanes.
S’il y a problème, c’est dans la lenteur du développement. Bien que le style soit vif, l’action progresse trop lentement, laissant le lecteur à piétiner lors de redites trop nombreuses des personnages et des redondances dans leur description. Certains passages auraient eu intérêt à tomber sous le crayon bleu de l’éditeur. S’il fait un peu plus de 450 pages, on aurait pu en tirer un excellent ouvrage qui en aurait compté la moitié. De plus, si l’ensemble du sujet est minutieusement ficelé, même s’il est trop suremballé, la fin m’a parue un peu simpliste.
La Muraille invisible de Henning Mankell, traduit du suédois par Anna Gibson, Éditions du Seuil, 2002. Si dans La peau du tambour l’informatique est accessoire au récit, elle occupe une place centrale dans le roman de Mankell. Décès d’un consultant en informatique devant un guichet bancaire automatique, enquête à un logis qui lui servait de bureau, découverte d’une chambre secrète, recours à un jeune hacker pour percer le mystère de l’ordinateur du disparu, et cyber ballades dans les grands réseaux informatiques de la haute finance sont au menu. Les descriptions techniques (réseaux, matériel, etc.) de Mankell sont réalistes, mais les non initiés apprécieront leur simplicité.
Dans le concret, l’action se déroule à Ystad (Suède) où Kurt Wallander est inspecteur de police. Il enquête sur le décès du consultant, même si tout porte à croire qu’il soit décédé de causes naturelles, mais aussi sur l’assassinat crapuleux d’un chauffeur de taxi par deux jeunes filles. Peu à peu, son enquête fait converger les deux événements et il découvre un vaste complot visant à saboter les rouages de l’économie mondiale. À l’image des réseaux qu’il utilise, «l’ennemi se révèle omniprésent, omnipotent et invisible.». Évidemment. Wallander et ses adjoints, avec l’aide du hacker repenti, parviendront à déjouer le complot.
Le récit est bien mené, sans longueur, et le personnage principal est bien campé et nous paraît sympathique. Proche de la retraite, c’est un enquêteur dont l’expérience se conjugue à un solide instinct qui ne lui nuira pas dans ce monde nouveau pour lui des réseaux informatiques..
Il y a plusieurs années, j’ai lu au sujet d’un criminel québécois en fuite qui avait trouvé refuge en Oregon et s’y était installé sous un nom d’emprunt dans une petite collectivité rurale. Il vécut ainsi durant quelques années sans être embêté jusqu’au jour où les sherrifs locaux se présentèrent à sa porte pour l’arrêter. Curieux à savoir qu’est-ce qui avait pu trahir son identité, l’enquêteur responsable de son arrestation lui confia que c’était son habitude de parler de la météo et d’y accorder beaucoup d’importance. Le limier, auquel le fugitif avait toujours paru suspect, avait découvert qu’il s’agissait d’un trait caractéristique aux Québécois. Il avait alors communiqué sa description à divers corps policiers du Québec pour en conclure que cet outsider était bel et bien l’homme recherché.
On comprend cette propension des Québécois à parler du temps qu’il a fait, qu’il fait et qu’on prévoit qu’il fera. Au printemps, on peut connaître une chute de 20 degrés en 12 heures. Sur une base annuelle, on doit composer avec des écarts de 75 degrés.
J’ignore s’il en est de même en Suède, mais tout au long de La Muraille invisible l’auteur nous renseigne d’une manière bien sentie sur le temps qu’il fait au moment où l’action se déroule. Sympathique, et ça aide a la visualisation de la scène sur l’«écran intérieur».
Voilà, trois polars en trois styles.
Au Canada, la récente étude sur la lecture et achat de livres pour la détente du ministère du Patrimoine canadien révèle que la catégorie dite «Espionnage, suspense, détective, aventure» se classait au premier rang des préférences de 24 % des femmes et de 14 % des hommes.
Pour ma part, j’ai habituellement peu le temps de lire des polars, et il me faut attendre la pause estivale pour m’y adonner. J’en ai lu trois récemment, trois très différents.
Dans le polar, et ceci s’applique à tous les autres genres d’écriture, tout tient au style. Et qu’est-ce que le style? Le thème même a inspiré certains grands. «Le style n’est que l’ordre et le mouvement qu’on met dans ses pensées» (Buffon). «Le style n’est qu’une manière de penser» (Flaubert). «Le style, c’est l’oubli de tous les styles» ou encore «Le style, c’est le mot qu’il faut» (Jules Renard).
Trois polars lus récemment, donc, et trois styles.
Journal d’un tueur sentimental de Luis Sepúlveda, traduit de l’espagnol par Jeanne Peyras, Editions Métaillé, 1998. Dans ce livre, l’auteur chilien fait dans le bref, 75 pages en gros caractères, une heure de lecture tout au plus. Comme journal aussi, c’est succinct, l’action se déroule sur une période de six jours. Écrit à la première personne, on ne connaît jamais le prénom ou le nom de ce tueur à gages, ni ceux de la Française dont il s’est amouraché, ni celui de son employeur, seule sa cible fait exception. Si bref et si concis est ce récit qu’on a peine à en décrire la trame sans dévoiler l’issue, sauf pour dire qu’on se retrouve en enfilade d’hôtels, d’avions, et de coups de téléphone pour une conclusion pour le moins abrupte. Le style est froid, contrairement à certains autres ouvrages de Sepúlveda, et le déroulement simpliste. Dommage.
La peau du tambour de Arturo Pérez-Reverte, traduit de l’espagnol par Jean-Pierre Quijano, Éditions du Seuil, 1997. Lorenzo Quart, le père Lorenzo Quart, est agent au service de l’Instituto Per Le Opere Esteriore (IOE) du Vatican, officiellement l’Institut pour les oeuvres extérieures, mais mieux connu comme le bras armé du Saint-Office, le service de renseignement du Vatican, «la main gauche de Dieu», «le service des sales affaires».
Un hacker s’introduit dans le système informatique central du Vatican et dépose un message dans la boîte de courriel personnelle du Saint-Père. Surnommé Vêpres par les services informatiques du Saint-Siège qui sont incapables de repérer l’origine de la communication, le pirate dit vouloir attirer l’attention du pape sur une petite église de Séville, construite au XVIIe siècle, et qui est l’objet de la convoitise de spéculateurs fonciers. «Une église qui tue pour se défendre...» écrit Vêpres. C’est l’église Nuestra Señora de las Lágrimas, Notre-Dame des Larmes, où deux morts suspectes se sont produites en peu de temps. L’IOE est saisie de l’affaire, et Quart hérite de la mission de l’éclaircir.
Ce n’est pas un roman de techno-fiction comme pourrait le laisser croire l’entrée en matière. Ce qui est au centre du roman c’est plutôt l’enquête à dimension très humaine que mènera Quart à Séville, les rencontres qu’il y fera, les tentations auxquelles il sera confronté. Comme disait La Bruyère, «Tout est tentation à qui la craint», et c’est le cas de Quart quant il fait la rencontre d’une aristocrate andalouse.
Le style de Pérez-Reverte, du moins en traduction, est efficace et alerte. En plus de généreuses précisions historiques sur la ville de Séville et de belles descriptions de la ville, l’auteur ouvre la porte sur les arcanes du Vatican. Après tout, que faisait Quart en mission pour l’IOE au Panama au moment de l’invasion étasunienne et de la chute de Noriega, et à Sarajevo aux plus sombres moments de la guerre civile? Des feux de souvenirs qui viendront hanter Quart par les chaudes nuits sévillanes.
S’il y a problème, c’est dans la lenteur du développement. Bien que le style soit vif, l’action progresse trop lentement, laissant le lecteur à piétiner lors de redites trop nombreuses des personnages et des redondances dans leur description. Certains passages auraient eu intérêt à tomber sous le crayon bleu de l’éditeur. S’il fait un peu plus de 450 pages, on aurait pu en tirer un excellent ouvrage qui en aurait compté la moitié. De plus, si l’ensemble du sujet est minutieusement ficelé, même s’il est trop suremballé, la fin m’a parue un peu simpliste.
La Muraille invisible de Henning Mankell, traduit du suédois par Anna Gibson, Éditions du Seuil, 2002. Si dans La peau du tambour l’informatique est accessoire au récit, elle occupe une place centrale dans le roman de Mankell. Décès d’un consultant en informatique devant un guichet bancaire automatique, enquête à un logis qui lui servait de bureau, découverte d’une chambre secrète, recours à un jeune hacker pour percer le mystère de l’ordinateur du disparu, et cyber ballades dans les grands réseaux informatiques de la haute finance sont au menu. Les descriptions techniques (réseaux, matériel, etc.) de Mankell sont réalistes, mais les non initiés apprécieront leur simplicité.
Dans le concret, l’action se déroule à Ystad (Suède) où Kurt Wallander est inspecteur de police. Il enquête sur le décès du consultant, même si tout porte à croire qu’il soit décédé de causes naturelles, mais aussi sur l’assassinat crapuleux d’un chauffeur de taxi par deux jeunes filles. Peu à peu, son enquête fait converger les deux événements et il découvre un vaste complot visant à saboter les rouages de l’économie mondiale. À l’image des réseaux qu’il utilise, «l’ennemi se révèle omniprésent, omnipotent et invisible.». Évidemment. Wallander et ses adjoints, avec l’aide du hacker repenti, parviendront à déjouer le complot.
Le récit est bien mené, sans longueur, et le personnage principal est bien campé et nous paraît sympathique. Proche de la retraite, c’est un enquêteur dont l’expérience se conjugue à un solide instinct qui ne lui nuira pas dans ce monde nouveau pour lui des réseaux informatiques..
Il y a plusieurs années, j’ai lu au sujet d’un criminel québécois en fuite qui avait trouvé refuge en Oregon et s’y était installé sous un nom d’emprunt dans une petite collectivité rurale. Il vécut ainsi durant quelques années sans être embêté jusqu’au jour où les sherrifs locaux se présentèrent à sa porte pour l’arrêter. Curieux à savoir qu’est-ce qui avait pu trahir son identité, l’enquêteur responsable de son arrestation lui confia que c’était son habitude de parler de la météo et d’y accorder beaucoup d’importance. Le limier, auquel le fugitif avait toujours paru suspect, avait découvert qu’il s’agissait d’un trait caractéristique aux Québécois. Il avait alors communiqué sa description à divers corps policiers du Québec pour en conclure que cet outsider était bel et bien l’homme recherché.
On comprend cette propension des Québécois à parler du temps qu’il a fait, qu’il fait et qu’on prévoit qu’il fera. Au printemps, on peut connaître une chute de 20 degrés en 12 heures. Sur une base annuelle, on doit composer avec des écarts de 75 degrés.
J’ignore s’il en est de même en Suède, mais tout au long de La Muraille invisible l’auteur nous renseigne d’une manière bien sentie sur le temps qu’il fait au moment où l’action se déroule. Sympathique, et ça aide a la visualisation de la scène sur l’«écran intérieur».
Voilà, trois polars en trois styles.




 Sans vous importuner des détails technico-techniques, disons que Blogger a modifié l’interface de publication faisant en sorte que des codes de mise en page s’inséraient automatiquement dans le gabarit des utilisateurs, avec pour résultat que ladite mise en page déterminée par l’abonné s’en trouvait modifiée. Dans certains cas (comme le mien), on avait droit à un chamboulement de colonnes, dans d’autres (comme chez
Sans vous importuner des détails technico-techniques, disons que Blogger a modifié l’interface de publication faisant en sorte que des codes de mise en page s’inséraient automatiquement dans le gabarit des utilisateurs, avec pour résultat que ladite mise en page déterminée par l’abonné s’en trouvait modifiée. Dans certains cas (comme le mien), on avait droit à un chamboulement de colonnes, dans d’autres (comme chez 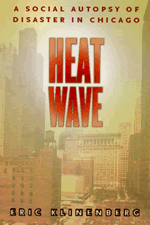 Chicago, 1995. Le mercredi 12 juillet, le Chicago Sun-Times publie un court article, relégué en page 3, sur l’imminence d’une vague de chaleur qui pourrait s’avérer mortelle (Heat Wave on the Way - And It Can Be a Killer). On annonce également que les taux d’ozone et d’humidité seront élevés, et que l’indice de chaleur (température ressentie) pourrait atteindre les 49C. Le lendemain, le mercure atteint les 40C, et l’indice de chaleur
Chicago, 1995. Le mercredi 12 juillet, le Chicago Sun-Times publie un court article, relégué en page 3, sur l’imminence d’une vague de chaleur qui pourrait s’avérer mortelle (Heat Wave on the Way - And It Can Be a Killer). On annonce également que les taux d’ozone et d’humidité seront élevés, et que l’indice de chaleur (température ressentie) pourrait atteindre les 49C. Le lendemain, le mercure atteint les 40C, et l’indice de chaleur 



